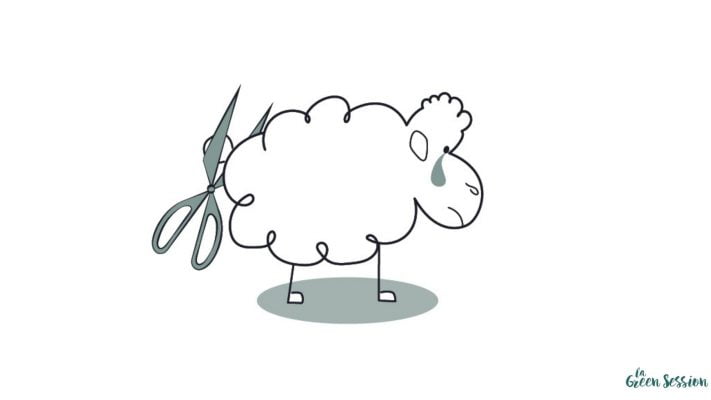Montagne (Ski, Snow...)
Comment ne pas avoir froid au ski ? La technique ultime
Le système des trois couches
Si toi aussi, tu te rappelles de ces longues journées de ski totalement frigorifié dans ta combinaison ou au contraire complètement on fire sous tes quinze couches de vêtements, lève la main ! (Et là une vague de solitude t’envahit au moment où tu te rends compte que t’es seul à lever la main derrière ton écran…)
Mais réjouis-toi, cette douloureuse expérience ne sera plus qu’un mauvais souvenir après avoir lu cet article.
Sommaire
- Base layer : la couche qui permet de maintenir la chaleur corporelle
- Mid-layer : la couche isolante
- Shell layer, softshell ou hardshell : la couche protectrice
Et non, ce n’est pas en accumulant cinq paires de gants et dix de chaussettes que tu réussiras à te maintenir au chaud. Si la sensation de froid se ressent directement au niveau des mains et des pieds, c’est parce que le sang circule vers les organes vitaux.
Et pour l’irriguer correctement vers les extrémités du corps, il est nécessaire de s’habiller chaudement en superposant plusieurs couches de vêtements.

Là normalement, tu congèleras nettement moins ! Et nous allons t’expliquer THE technique, employée à l’origine par les amateurs de sports extrêmes afin d’optimiser leur confort et leurs capacités physiques. Aujourd’hui, cette stratégie dite « des trois couches » se démocratise largement auprès des amateurs de sports d’hiver, notamment de ski.
Si ce thème a déjà été traité maintes et maintes fois par le milieu du sport outdoor, on te propose ici d’aborder le sujet dans une perspective éco-responsable, en se tournant vers des matières en adéquation avec le respect de l’environnement.
Notre objectif est de dispenser des conseils utiles pouvant aider à choisir en toute conscience les matières qui constitueront tes trois couches de vêtements. Et si tu as toi-même des idées à proposer, n’hésite pas à nous le faire savoir en commentaire.
On essaie de décrypter tout ça, c’est parti !
Base layer : la couche qui permet de maintenir la chaleur corporelle
Le principe
Venons-en au cœur du sujet : le système des trois couches se décline en… trois phases (bravo la logique), la première étant la couche de base correspondant aux sous-vêtements techniques.
Le principe de cette première étape vestimentaire consiste non seulement à éviter la sensation désagréable de froid, mais également à évacuer la transpiration pour permettre à la peau de rester bien au sec.
Exit le coton qui fait l’effet d’une éponge mouillée sur l’épiderme. On se tourne vers des matières en fibres synthétiques, comme le polyester. Winner toute catégorie de l’industrie textile sportive, le polyester est une fibre synthétique composée de polymères (désignant un ensemble de macromolécules), très appréciée pour sa résistance, sa durabilité et sa capacité à sécher rapidement.
Là où ça coince…
Oui, mais ! Le polyester a l’inconvénient d’être une matière moins respirante qu’une fibre naturelle, à cause de son très faible taux d’absorption de l’humidité. Il se pose de fait en terrain favorable au développement d’une charmante bactérie du nom de micrococcus, qui au contact prolongé du polyester, entraîne une odeur pas bien jojo (sympa pour accompagner la raclette de retour au chalet !).

Mais surtout, il s’agit là d’un matériau créé à partir d’éléments plastiques, générant un impact environnemental non négligeable. Lors de sa fabrication, le polyester nécessite l’utilisation de ressources pétrochimiques non renouvelables.
Les problèmes odorants qu’il génère rapidement après l’effort, combinés à un lavage régulier en machine contribuent grandement à la pollution : lors du lavage de vêtements en polyester, d’infimes particules de plastique sont rejetées avec les eaux usées domestiques, sachant qu’une grande quantité de ces eaux usées se retrouve dans les rivières, puis les mers et les océans.
Notons également qu’après usage, le polyester met plusieurs décennies à se décomposer, et que les solutions de fin de vie de ce matériau (par enfouissement ou incinération) sont loin d’être satisfaisantes écologiquement parlant.
A lire aussi :
Quelle matière pour mon base layer ?
Les solutions alternatives envisagées
Afin de pallier (en partie) la consommation grandissante du plastique, une alternative a été trouvée : celle du polyester recyclé, aussi appelé rPET.
Celui-ci est obtenu à partir de plastique existant, puis filé pour créer de nouvelles fibres de polyester avec une qualité comparable à celle de son bon vieux sosie.
Mais il y a là encore un mais : d’une part le rPET libère également des microparticules au moment du lavage en machine, et d’autre part, ce dernier ne peut pas être recyclé à l’infini, sans quoi sa qualité finit par se détériorer. Sur le premier point, tu peux utiliser des sacs de lavage (aussi appelés guppy bag) à mettre en machine afin de limiter la quantité de microparticules à se balader dans les rivières et les mers. Fabriqués en polyamide, les guppy bag sont entièrement recyclables après utilisation.
Mais bon, dans un monde idéal, le mieux serait de consommer moins de plastique. Alors, vers quoi peut-on se tourner ?
Les fibres naturelles ! Celles-ci constituent des alternatives intéressantes au polyester, tout en ayant sensiblement les mêmes qualités. Il est aujourd’hui courant de trouver de la laine mérinos – du nom des moutons sur lesquels elle est prélevée, la plupart d’origine australienne – en composant principal de la base layer.
De la laine ? L’idée n’est pas si folle, puisqu’elle a l’avantage d’être résistante et de ne pas retenir les odeurs tout en gardant bien au chaud (on n’a jamais vu un mouton mourir de froid !).

Cependant, quelques points négatifs viennent assombrir le tableau : l’élevage des moutons nécessite toujours plus de pâturages, tandis que les activités liées à l’élevage sont en grande partie responsables de la déforestation, du réchauffement climatique (émission de gaz à effet de serre) et de la pollution de l’air.
Et qu’en est-il du bien-être animal ? Les moutons mérinos (notamment australiens) doivent subir le mulesing, une ablation d’une partie de la peau située autour de la queue afin d’empêcher le développement de myiases (infections causées par des asticots).
L’opération – barbare, on peut le dire – est extrêmement douloureuse pour les agneaux et engendre des séquelles, car la peau à vif favorise paradoxalement les infections. Si l’Australie avait promis de bannir définitivement le mulesing en 2010, une enquête de l’association PETA en 2018 a révélé que les mutilations infligées aux moutons sont encore d’actualité…
La petite bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de s’équiper avec de la laine usagée, limitant drastiquement l’impact écologique en ce qui concerne le processus de fabrication.
La laine recyclée est alors obtenue à base de vêtements en laine ou directement de chutes de laine, mais le matériau recyclé est souvent mélangé à des fibres synthétiques comme le polyester (oui, encore lui). Ce qui est bien, c’est que l’industrie textile française favorise de plus en plus la laine recyclée, et l’on trouve sur le territoire plusieurs usines de recyclage et filatures.
Un dernier tour d’horizon nous amène alors à une autre fibre naturelle : la viscose de bois, obtenu par le filage de fibres de cellulose de bois de hêtre ou d’eucalyptus. Il est obtenu à partir de solvants non toxiques. Bien que sa fabrication requiert un processus chimique, le modal est une fibre entièrement naturelle et végétale, davantage préconisée pour la base layer en raison de sa respirabilité et de ses capacités isolantes.

En résumé
Pour démêler tout ça (parce qu’on a bien conscience que ce n’est pas si simple), nos conseils seraient de privilégier dans tous les cas la laine recyclée, une bonne alternative d’un point de vue qualitatif et écologique, malgré l’origine animale du matériau, mais aussi les fibres de modal, qualitativement proches de la laine, avec l’option végétale en plus ! Sachant que l’un et l’autre sont fabriqués en France et en Europe, l’empreinte carbone s’en trouve également réduite, et ça c’est aussi un bon point.
A lire aussi :
Les 6 meilleurs base-layers éco-responsables pour le ski
Mid-layer : la couche isolante
Le principe
Si tout est clair jusque-là, passons à la seconde couche dont la fonction principale n’est autre que l’isolation.
Parce que oui, c’est bien beau d’avoir enfilé des sous-vêtements thermiques, ça reste malgré tout insuffisant. Composée de matières polaires ou duvet plus légères que les pulls ou les sweats lambdas, celle-ci permet de retenir la chaleur du corps tout en transférant l’humidité vers l’extérieur.
Tout un programme ! Et pourtant en cas de surchauffe et si par mégarde tu commences sérieusement à cramer intérieurement, c’est finalement cette couche intermédiaire qu’il ne faudra pas hésiter à retirer (pas la première, ni la dernière).
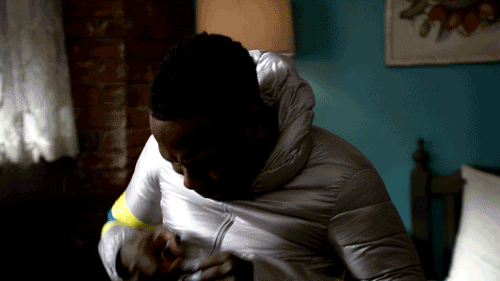
Là où ça coince…
Le problème, c’est que la matière polaire, composée en partie de fibres de Polyéthylène Téréphtalate (tout comme le polyester) comporte donc les mêmes inconvénients environnementaux que son p’tit pote.
En parallèle, le duvet présente des qualités isolantes intéressantes, car il emprisonne l’air corporel tout en le maintenant à bonne température.
Cependant, son utilisation dans les textiles est plutôt recommandée par temps sec et glacial. En cas de pluie et forte humidité, celui-ci ne garde plus l’air chaud et devient lourd à porter.
Mais surtout, il est nécessaire de rappeler que les conditions d’élevage des oies et des canards sont pointées du doigt : la plumaison à vif et le gavage des animaux sont des pratiques quotidiennes…
Notons tout de même que les doudounes et les polaires existent aussi en matériaux recyclés, tels que les bouteilles en plastique ou bien les vieux vêtements en polyester.
Et en réalité, la variété de tissus aujourd’hui employés à la fabrication des vêtements mid-layer est assez grande. Étant aussi un très bon isolant, la laine mérinos fait partie du lot, souvent associée au polyester (recyclé ou non) pour renforcer la résistance d’une doudoune par exemple.
Les solutions alternatives envisagées
Concernant la production de duvet, certaines enseignes du sport outdoor ont choisi d’agir face aux actes de maltraitance subis par les volatiles en refusant de travailler avec les élevages ne respectant pas le bien-être animal (signalons au passage qu’on ne peut jamais vraiment parler de bien-être dès lors que l’on parle d’élevage intensif), tout en instaurant des mesures de traçabilité des produits.
Comme pour la laine, le recyclage de duvet de plumes existe (en France aussi), qualifié dans le jargon de “garnissage couché”. Ces plumes sont d’abord collectées, triées puis lavées et séchées dans des étuves, puis re-triées et dépoussiérées avant d’être opérationnelles pour servir à la fabrication de nouveaux textiles.

En résumé
Les versions recyclables des matières premières employées pour la mid-layer, comme les fibres polaires et la laine mérinos sont recommandées, car elles limitent le gaspillage et n’encouragent pas l’industrie textile à en fabriquer de nouvelles.
Concernant le duvet recyclé, la question est un peu plus problématique à l’heure actuelle puisqu’il ne semble, a priori, pas exister de vêtements outdoor élaborés avec ce matériau, mais il n’est pas exclu que cette alternative investisse le milieu du sport dans un avenir proche.
Shell layer, softshell ou hardshell : la couche protectrice
Le principe
La couche externe est également essentielle, son rôle étant de protéger du froid, du vent, de la pluie, de la neige, de la grêle et j’en passe et des meilleurs, tout en évacuant la transpiration.
Elle se décline en deux variantes : la softshell et la hardshell. La première est une veste coupe-vent et respirante qui protège bien du froid mais pas de la pluie, tandis que la deuxième est dite imper-respirante : elle est imperméable ET respirante, permettant donc de se prémunir des aléas extérieurs autant que de tout effet indésirable interne : c’est cool d’éviter d’être trempé par la pluie, et encore plus sympa de ne pas macérer dans sa sueur après deux heures dans la neige.
On préférera donc une veste hardshell à une softshell pour sa double capacité, et même si celle-ci ne tient pas chaud, la mid-layer pallie cet inconvénient.

Bon, on l’a deviné : la qualité n°1 de la hardhsell est son imperméabilité. Mais ce n’est pas si simple, car on évalue l’imperméabilité sur différents niveaux grâce à l’unité Schmerber, mise au point par Charles Edouard Schmerber (1894-1958), et qui est aujourd’hui visible sur les fiches techniques des produits sportifs outdoor.
Le test permettant de mesurer le degré d’imperméabilité d’une matière consiste à la placer sous une colonne d’eau graduée en se rapportant à la hauteur d’eau visible avant que les premières gouttes ne traversent le tissu. En somme : plus la hauteur d’eau est élevée, plus le vêtement est imperméable.
A partir des 10 000 Schmerber (1 Schmerber = 1mm de colonne d’eau), un tissu est considéré comme bien imperméable, et au-delà de 20 000, il bénéficie d’une protection idéale. Pour pratiquer le ski, il est donc recommandé d’opter pour une veste se situant au moins à 20 000 Schmerber.
Là où ça coince…
Pour un maximum d’efficacité, l’idéal est d’opter pour des vestes de ski hardshell dotée d’une membrane, car ces pores empêchent l’eau extérieure de pénétrer à l’intérieur, tout en laissant la transpiration s’évacuer par l’intermédiaire de ces mêmes pores.
Si la plus connue d’entre elles est la fameuse Gore-Tex, elle a été épinglée par Greenpeace comme étant clairement “dangereuse pour la santé” en raison des composés perfluorés (PFC) toxiques qu’elle contient, nocifs pour l’environnement et cancérigènes pour l’humain.
Et la marque est malheureusement loin d’être la seule dans ce cas, de nombreux vêtements sportifs comportent effectivement des PFC (et pas que héhé, ce serait trop facile ! On en trouve aussi dans les poêles notamment. Et puis c’est volatile ces p’tites bêtes, si bien que l’on en trouve partout).
Les solutions alternatives envisagées
Mais là encore, des solutions alternatives existent ! Tout d’abord, tu peux guetter la mention PFC-free afin de t’assurer qu’il n’existe aucun déperlant comportant des PFC sur ta veste de ski, tout en regardant si celle-ci est fabriquée à partir de matériaux recyclés.

Plusieurs marques se sont en effet penchées sur le problème des composés toxiques et ont mis au point des membranes sans PFC, tandis que d’autres ont carrément choisi de fabriquer des vestes sans membrane, en les remplaçant par du coton (bio!) tissé très serré.
A lire aussi :
Les 8 meilleures vestes de ski éco-responsables
PFC : Pourquoi nos vestes de ski contaminent-elles la planète ?
Pour conclure
Si tu es arrivé jusqu’ici, tu sais maintenant comment braver le froid hivernal, mais tu as surtout pu remarquer que le dilemne concernant les matériaux utilisés à la base de la stratégie des trois couches est réel.
S’équiper correctement pour pratiquer le ski nécessite alors de faire des choix quant aux matières premières que tu souhaites adopter, en espérant que tu y vois plus clair à présent.
Ah, et une dernière info (dans le doute, on sait jamais…), tous ces petits tips ne te dispensent pas de porter des chaussettes et des gants, tu l’as compris. S’il ne sert à rien d’empiler les chaussettes, on s’accorde en revanche sur le fait qu’il est préférable de porter des gants ou moufles et des sous-gants pour favoriser au maximum la chaleur.
Ainsi équipé, tu as toutes les chances de devenir – non pas le meilleur dresseur de Pokémons – mais le prochain Jean-Baptiste Grange (on y croit !) En attendant d’être sur les pistes, tu peux rejoindre la communauté en t’abonnant à notre newsletter pour recevoir chaque jeudi ta petite dose d’information green.